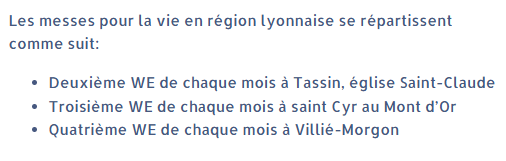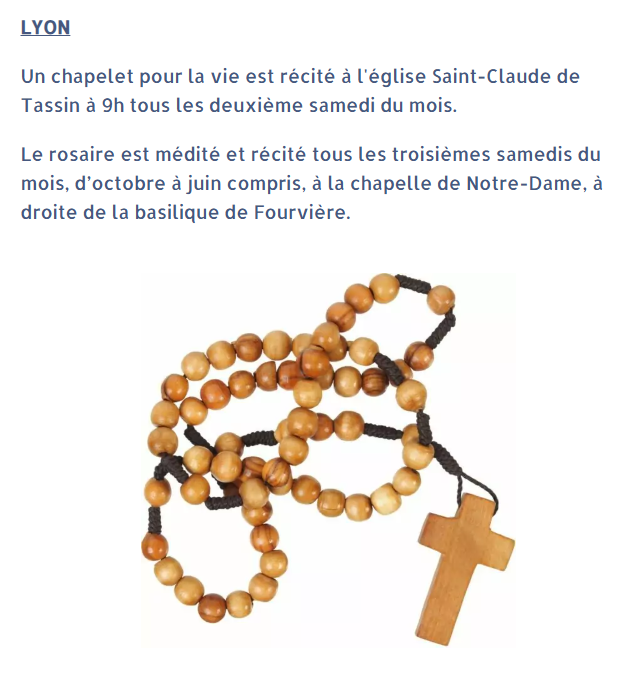Dans la mesure où il rejoint le bon et le vrai, le beau, loin d’être accessoire, fait partie intégrante de ce que les parents transmettent à leurs enfants. Par quoi passe cette éducation au beau ? Regards croisés d’un professeur d’art appliqué et d’une passionnée de la transmission du beau.
Entretiens croisés avec
Christian Mercier de Beaurouvre est enseignant en Arts appliqués en filières professionnelles à la Fondation d’Auteuil
Valérie d’Aubigny est formatrice du parcours Apprendre à voir d’Ichtus (voir « Zoom »), critique littéraire jeunesse, auteur des ouvrages Une bibliothèque idéale – que lire de 0 à 16 ans, (éd.Critérion) et Donner le goût de la lecture aux enfants (éd. Artège)
Il semble évident d’éduquer les enfants au bien. Est-il aussi important de les éduquer au beau ? Qu’entend-on par là ?
Christian Mercier de Beaurouvre : Bien au-delà de mon métier de professeur en arts appliqués, la recherche du beau me semble très importante. Je dirais que le bien, c’est l’harmonie du spirituel, et le beau, l’harmonie du matériel. Cela se traduit dans l’art, bien sûr, les arts décoratifs, mais aussi de mille manières dans la vie de tous les jours : la façon de s’exprimer, la tenue à table, la qualité de l’habillement, ou encore, par exemple, le protocole dans les plus hautes sphères de l’État. L’harmonie y est réfléchie, les choses ont un sens. Je fais aussi la distinction entre la beauté et la créativité. On les confond souvent, puisque l’art moderne se pique d’être créatif plus que d’être beau, portant sur la beauté un regard secondaire, voire négatif. Enfin, pour définir le beau, je repense à une phrase du cardinal Vingt-Trois, venu inaugurer dans ma paroisse, Saint-Michel-des-Batignolles, à Paris, la statue de l’Archange, réinstallée au sommet du campanile après avoir été déboulonnée à la suite d’une tempête : « Cette statue est importante parce qu’elle est totalement inutile », avait-il dit en substance : « Elle est juste belle. Et la beauté rend la vie supportable. »
Valérie d’Aubigny : Oui, éduquer au beau est aussi important que d’éduquer au bien. En fait, cela se fait très naturellement et dès le plus jeune âge. Un tout-petit qui grandit dans vos bras va forcément vous entendre passer par les émotions de l’émerveillement, de la joie devant ce qui est beau. Ce goût des belles choses se transmet plus en étant qu’en faisant. Grandir en capacité d’émerveillement est important pour un enfant. Cela irrigue toutes les fibres de son être en croissance : le corps avec ses sens, le cœur avec sa sensibilité, l’esprit avec ses connaissances et l’âme avec la transcendance. En fait, l’éducation au beau est aussi importante que l’éducation au bien et au vrai, car les trois se nourrissent les uns des autres, et chacun conduit aux deux autres, comme le disait Jean Ousset, qui a notamment écrit À la découverte du beau, un livre que je recommande. On retrouve cette idée dans la magnifique Lettre aux artistes de Jean-Paul II : « La beauté est en un certain sens l’expression visible du bien, de même que le bien est la condition métaphysique du beau. »
Quelles sont à vos yeux les différentes manières d’éveiller les enfants et les jeunes à la beauté ?
C.M.B. : Je commence par aider mes élèves à distinguer, dans ce qui les entoure, ce qui est utile et ce qui est gratuit. Je leur apprends qu’une partie de nous réagit à ce qui est gratuit, en essayant de leur faire expérimenter des choses plaisantes. Au départ, l’expérience du beau leur vient de l’extérieur. Ils la ressentent sans l’analyser… Puis, peu à peu, j’essaie de les mettre en situation de produire eux-mêmes du beau. Et pour cela, je me montre exigeant, pour le soin par exemple : je suis convaincu que pour valoriser une production artistique, pour faire de belles choses il faut que l’on se donne du mal. En art graphique, mon rôle est de les aider à tracer ou peindre des traits et des taches qui aient du sens ou procurent une émotion. Et quand ils y parviennent, les aider à apprécier leur travail et à persévérer.
V. d’A. : L’éducation au beau n’est pas cérébrale. Elle s’éduque par le regard que l’on porte autour de soi. Il est important de montrer aux enfants qu’il y a du beau partout, dès lors que quelque chose nous évoque un sentiment de plénitude. L’autre jour, j’ai ressenti cela dans un quartier de ville gris et banal, en entendant le chant d’un merle. Attention : s’éveiller et éveiller ses enfants au beau n’a rien à voir avec le fait d’avoir une culture ou une éducation particulière : quels que soient notre milieu ou nos connaissances, nous avons tous cette capacité à nous émerveiller et à ressentir une émotion en présence de la beauté. N’ayons pas peur, parents, de dire ce que nous ressentons quand nous sommes émus devant quelque chose que nous trouvons beau. Parfois, notre pudeur nous arrête. Or c’est aussi comme ça que nous apprenons à nos enfants à s’émerveiller eux-mêmes.
Quelles sont les vertus de cette éducation au beau ?
C.M.B. : Je crois surtout que le beau a la capacité de tout transformer. Prenons l’exemple d’un plat de riz : si vous le cuisinez juste à l’eau, vous ferez simplement en sorte de ne plus avoir faim. Si vous y ajoutez un accompagnement, des condiments, ce sera déjà meilleur. Si, en plus, vous le présentez dans un beau plat avec trois feuilles d’estragon et le portez sur une jolie table bien décorée, cela change tout ! Enfin, vous le partagez avec des amis… : ce sera toujours le même plat de riz, mais il aura une valeur très différente. Pour moi, la beauté n’apporte pas seulement quelque chose : elle est vitale.
V. d’A. : Dans une famille, le beau est un lien, il tisse une culture familiale, des références communes. Il en va de même pour un pays, d’ailleurs : il suffit de voir comme Notre-Dame de Paris peut être un ciment national. L’éducation au beau éveille aussi l’esprit critique : savoir reconnaître ce qui est beau, c’est aussi savoir mettre les choses en perspective, sur des terrains extrêmement variés. Sur un plan plus psychologique, goûter le beau ensemble, avoir appris à voir en famille, nous permet d’approcher la singularité de chacun de nos enfants avec une certaine distance, et donc avec respect.
Comment se manifeste la sensibilité à la beauté chez les jeunes que vous côtoyez ?
C.M.B. : Elle se manifeste d’une manière curieuse pour moi qui n’ai pas le même âge ni la même histoire que les élèves. Ils vont de la troisième à la deuxième année de CAP. Beaucoup sont issus de l’immigration, certains sont des mineurs isolés, d’autres sont en rupture avec tout ce qui est scolaire. Le beau n’est certainement pas leur priorité et c’est mon défi que de les aider à le leur faire découvrir. Je remarque que leurs émotions esthétiques les plus communément partagées sont liées à la musique. Pour eux, c’est surtout le rap. Sans en être connaisseur, je vois bien qu’il y a des chansons qui sonnent bien et d’autres moins : elles comportent des allitérations ou des rythmes que ces jeunes ont plaisir à entendre et à répéter. Le goût esthétique des jeunes à qui j’enseigne se retrouve aussi dans le design des voitures de luxe, dans leur tenue vestimentaire — ils peuvent mettre tout leur argent pour acheter une « belle » casquette de marque —, ou dans le sport : pour eux, un match de foot est un spectacle. Ils sont capables de le revoir une deuxième fois : l’enjeu du score a disparu, il ne reste plus que la beauté du match.
V. d’A. : Je remarque d’abord chez eux une grande simplicité : aborder le beau leur est plus naturel que chez les adultes, parfois entravés par du respect humain. Dans les formations « apprendre à voir » que je donne, les enfants sont aussi très exigeants : ils n’hésitent pas à dire ce qu’ils ne trouvent pas beau. Souvent, leur sensibilité au beau se manifeste par une envie de renouveler l’expérience qu’ils ont aimée : revoir ce tableau, retourner visiter ce château ou se promener dans ce jardin, réentendre cette histoire qu’on leur a lue… Car le beau donne de la joie !
Pouvez-vous nous raconter un souvenir ou une anecdote qui vous a marqué et qui dit quelque chose de l’importance de cette éducation ?
C.M.B. : Quand les jeunes arrivent à produire quelque chose de beau, encore faut-il qu’ils le voient et que cela les touche. Ce n’est pas si évident. Je me souviens d’un garçon qui dessinait très bien, mais refusait toute mise en couleur. Je l’y encourageais, mais il craignait que cela gâche ses dessins. Rien n’y faisait et j’avais même cessé de lui en parler. Et puis, à la fin de l’année, il est venu me montrer son carnet de dessin : il y avait de la couleur à toutes les pages ! Il était fier de lui. Je ne sais pas par quel mystérieux revirement il s’était ouvert à une nouvelle manière de produire du beau, mais je peux imaginer qu’il a continué par la suite. Il n’est pas exclu que je contribue à améliorer la vie de mes élèves en les ouvrant à la beauté. Quand je vois le plaisir que cela me procure à moi-même, je suis heureux de le partager avec eux.
V. d’A. : C’est drôle, parce que l’anecdote à laquelle je pense s’est justement déroulée au sein de la Fondation d’Auteuil, qui nous avait demandé de monter un parcours d’éducation affective par l’art. C’était très touchant de projeter des œuvres de Fra Angelico, de Van Gogh ou de Vermeer devant des enfants qui n’étaient absolument pas familiers de cet univers, et qui n’avaient pas un vocabulaire très châtié ! Notre travail était de les aider à décrire ce qu’ils avaient sous les yeux. Ils étaient parfois émus aux larmes, et cherchaient les mots les plus beaux qu’ils connaissaient pour dire la beauté de ce qu’ils voyaient. Je me souviens d’un petit garçon de cours élémentaire, qui a pris la parole. Il avait vu un détail que personne n’avait remarqué dans un tableau de Watteau : une cheville juste aperçue sous un beau manteau de satin, qui donnait une vraie touche de légèreté à l’ensemble. Plus tard, les animateurs m’ont dit que ce garçon ne parlait jamais habituellement. Je crois vraiment que la beauté a cette capacité à nous ouvrir et à nous révéler à nous-mêmes.