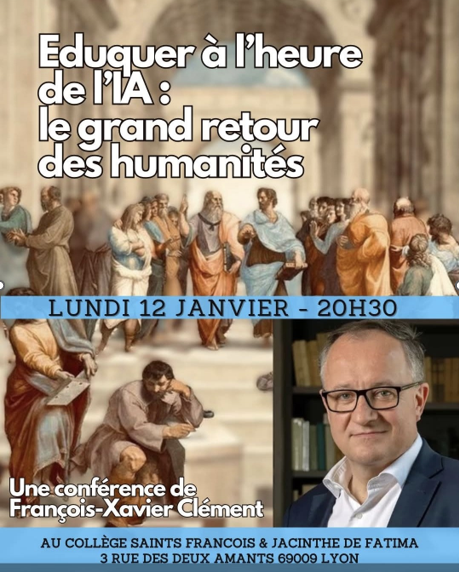Archives de catégorie : Non classé
LA FRATRIE, UN MODELE D’INCLUSION.(article CNAFC)
En côtoyant la différence dès leur plus jeune âge, et avec beaucoup de naturel, les frères et sœurs d’enfants porteurs de handicaps ont beaucoup à apprendre à notre société en matière d’inclusion.
Aujourd’hui, on parle beaucoup de l’inclusion des personnes porteuses de handicaps, cela est positif. Parfois pourtant, cette inclusion semble contenir implicitement l’injonction à être « comme les autres ». Alors, penchons-nous sur cette « inclusion naturelle » pratiquée dans les fratries, pour voir comment elle s’y vit.
Tant que les enfants sont assez jeunes, tout se fait de manière très naturelle. Parler de handicap est incongru. Avec l’âge et les regards extérieurs, la prise de conscience vient peu à peu. Les écarts se creusent quand le plus petit « passe devant », et acquiert des compétences que n’a pas son aîné. Ce sont des moments qui paraissent douloureux, mais qui permettent à chacun d’avancer dans l’acceptation du handicap, de grandir. Cela requiert d’en parler librement et aussi souvent que possible.
La famille est une bonne école pour apprendre à vivre ensemble et à prendre soin les uns des autres. Le handicap agit comme booster. Il crée une solidarité particulière au sein de la fratrie et dans la relation avec les parents. Les enfants voient leurs parents souffrir et se réjouir, ils les voient démunis, ils les voient se battre pour relever ce défi éducatif particulier et constatent qu’ils ne savent pas toujours s’ils font les bons choix. Par la vie avec le handicap, accepter, aimer l’autre dans sa différence leur est bien souvent plus naturel.
Pour autant, ils souffrent par moment de la différence de traitement qui peut être perçue comme une injustice ou une inégalité. Car le handicap prend parfois beaucoup de place et de l’attention des parents.
À l’extérieur, par contre, les enfants qui vivent avec un frère ou une sœur différents sont les premiers à s’indigner du moindre regard ou de la moindre parole d’exclusion ou de jugement sur le handicap.
En somme, l’inclusion d’un enfant porteur de handicaps dans une fratrie ne se décrète pas : elle se vit, au jour le jour, dans la richesse des liens, les ajustements constants et les émotions partagées. Elle n’est ni parfaite ni facile, mais elle simplement humaine. Elle façonne les frères et sœurs, les rend souvent plus attentifs à l’autre, plus tolérants, plus conscients des fragilités de chacun. À condition de leur offrir un espace pour s’exprimer, de reconnaître leurs besoins spécifiques, et de leur dire qu’ils comptent tout autant, cette expérience peut être fondatrice. Car vivre avec la différence au cœur même de sa famille, c’est peut-être apprendre très tôt à aimer sans condition et en inclusion.
Claire Gilles
Les « Chantiers atypiques »
Anciennement appelés « Chantiers zèbres », il en en existe dans de nombreuses régions. Les Chantiers atypiques accueillent des parents dont les enfants sont HPI ou TDAH principalement. Ces parents éprouvent le besoin de se retrouver pour échanger sur leurs enfants qui ont un fonctionnement atypique.
(ARTICLE CNAFC) TIK TOK POINTE DU DOIGT POUR SES EFFETS NOCIFS SUR LES MINEURS.
Le 11 septembre, la commission d’enquête portant sur « les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs » de l’Assemblée nationale a publié son rapport. Que contient-il ?
Une prise de conscience collective des dangers de TikTok
Débutée en mars 2025, cette commission d’enquête avait pour mission d’étudier les mécanismes de captation de l’attention du réseau social et ses conséquences sur le bien-être psychologique et le développement cognitif des jeunes mineurs. Ce réseau social d’origine chinoise est le plus populaire chez les jeunes (63% des utilisateurs ont moins de 24 ans) et fonctionne via la diffusion infinie de courtes vidéos. Les membres de la commission d’enquête ont mené de nombreuses auditions de spécialistes, d’influenceurs, de représentants de plusieurs plateformes dont TikTok et des victimes de cette dernière afin de nourrir leurs recommandations. Une consultation publique citoyenne particulièrement productive (30 000 réponses dont presque 19 000 venant de lycéens) a permis d’enrichir la réflexion des députés.
Le rapport est sans appel : le modèle TikTok est très néfaste pour les mineurs. Dans son avant-propos, le président de la commission d’enquête, Arthur Delaporte, a tenu à dédier ce rapport aux victimes auditionnées le 15 mai 2025.
Quelques chiffres
Avec 27,8 millions d’utilisateurs, la France est le plus gros marché en Europe pour TikTok. Même si depuis le confinement le nombre de séniors ne cessent de croitre, 63% des utilisateurs de ce réseau social ont moins de 24 ans. L’inscription aux réseaux sociaux est théoriquement interdite aux mineurs de moins de 13 ans.
L’algorithme des contenus s’adapte aux préférences des utilisateurs, jusqu’à les enfermer dans des schémas uniques et sans nuances. Après seulement quelques minutes d’utilisation il est possible de visionner des vidéos violentes, racistes, antisémites ou sexistes. De plus, le harcèlement moral et les commentaires haineux peuvent engendrer l’altération de la santé mentale et aller jusqu’à des actes irréversibles et tragiques. La commission d’enquête révèle également la présence de la pédocriminalité et le détournement d’images d’enfants. Selon l’Office anti-cybercriminalité (OAFC), entre janvier et mai 2025 l’atteinte aux mineurs représentait 7,5% de l’ensemble des signalements contre 3,15% en 2024.
Les chiffres sont formels : la détérioration de la santé mentale est générale et préoccupante et touche plus les filles. Un lycéen sur dix déclare déjà avoir fait une tentative de suicide, 13% des enfants scolarisés âgés de 6 à 11 ans auraient au moins un trouble probable de santé mentale et 8,3% des enfants de 3 à 6 ans ont une difficulté probable. Entre 2019 et 2023, on observe une augmentation de 60% des traitements par antidépresseurs chez les jeunes de 12-25 ans.
A l’heure où les jeunes s’informent principalement via les réseaux sociaux, TikTok est une source de désinformation massive. En mai dernier, une enquête du média The Guardian montrait que plus de la moitié des 100 contenus TikTok les plus visionnés sous l’hashtag « mentalhealthtips » (astuces de santé mentale) contenait de la désinformation.
Un modèle économique opaque et peu protecteur pour les mineurs
En 2024, le chiffre d’affaires mondial de TikTok était de 39 milliards de dollars (+63% par rapport à 2023). Le modèle économique de TikTok repose sur l’économie de l’attention, qualifiée en 2022 par le Conseil national du numérique comme « un ensemble de dispositifs mis en œuvre afin d’extraire une valeur marchande à partir de la captation de l’attention des utilisateurs ». Couplée à l’économie de la donnée, la majorité des revenus de TikTok est issue de la publicité. Le profilage des utilisateurs par TikTok est très efficace, à tel point que les spécialistes estiment qu’il est possible d’anticiper leurs intérêts et comportements. Le Conseil national du numérique parle même d’une économie de la manipulation.
Les contenus clivants sont susceptibles d’obtenir plus d’engagement des utilisateurs et donc d’être plus mis en avant par les algorithmes. De ce fait l’intérêt économique ne protège pas les jeunes utilisateurs. La notion de l’argent est même transformée avec la possibilité de donner aux influenceurs des cadeaux virtuels lors des lives (diffusion d’un contenu en direct où l’influenceur peut communiquer plus directement avec sa communauté).
Cependant, le rapport de la commission d’enquête indique qu’il n’a pas été possible de déterminer avec précision le modèle économique de la plateforme chinoise. Cette dernière est critiquée pour son manque de transparence sur certaines informations économiques, dont la répartition de ses revenus. La qualité des réponses apportées par TikTok sur son fonctionnement économique a été considérée « aux mieux évasive, et au pire insincère ». Malgré cela, le rapport conclut formellement que le profit économique est la motivation première de l’entreprise, au dépend du bien-être des utilisateurs.
La protection des mineurs passe par une régulation européenne forte
En vigueur depuis le 17 février 2024, le Digital Services Act (DSA) est aujourd’hui le règlement européen de référence pour la régulation des entreprises comme TikTok. Aujourd’hui, TikTok semble ne pas respecter son article 28 qui stipule que les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs ont l’obligation de « garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service ».
Face à une mobilisation croissante des États européens et surtout de la France, la Commission européenne a publié, le 14 juillet 2025, de nouvelles lignes directrices sur les mesures visant à garantir un niveau élevé de confidentialité, de sécurité et de sûreté pour les mineurs en ligne.
Quel avenir pour la protection des mineurs ?
La principale préconisation des 43 recommandations est d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans contre 13 ans actuellement. Seules les simples messageries ne seraient pas concernées par cette interdiction. Un changement de législation doit se faire à l’échelle européenne, et par défaut à travers le droit national. Cette mesure avait été soutenue par de nombreux auditionnés lors des travaux de la commission d’enquête, dont la ministre déléguée chargée du Numérique Clara Chappaz. Concernant les jeunes de 15 à 18 ans, un couvre-feu numérique de 22h à 8h permettrait une utilisation raisonnée des réseaux sociaux.
Les auditions ont révélé l’effacement du rôle des parents dans l’encadrement de l’usage des réseaux sociaux par leurs enfants. Même si parfois les parents reconnaissent que laisser les mineurs est une solution de facilité pour « avoir la paix à la maison », il n’en reste pas moins qu’ils sont démunis par les stratégies de contournements des jeunes. Face à cette situation qui abime l’autorité parentale et fragilise les relations sociales, la commission d’enquête soutient la création d’un délit de négligence numérique dans le code pénal en cas de manquements graves des parents dans la protection de leurs enfants. Au préalable de cette proposition, il y aurait la mise en place d’une campagne d’information massive sur les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux.
Afin de diffuser les bonnes pratiques et sensibiliser sur les enjeux du numérique, le rapport encourage la mise en place de séances d’éducation aux médias via l’intervention d’associations auprès des élèves. La communauté éducative devrait également être formée systématiquement et régulièrement à ces enjeux.
Les recommandations pour le temps scolaire
Le temps scolaire, où les parents ne peuvent exercer un contrôle sur leur enfant, est à repenser pour éviter toutes distractions négatives à l’apprentissage. En ce sens et dès janvier prochain, la commission d’enquête est favorable à l’interdiction des téléphones portables dans les lycées. Il s’agirait donc d’une extension du dispositif « portable sur pause » qui a été généralisée lors de cette rentrée scolaire avec le bannissement des téléphones dans les collèges publics.
Alors que la surexposition aux écrans peut entrainer des difficultés dans l’apprentissage, les établissements scolaires se dotent de plus en plus d’outils numériques modernes. Face à ce paradoxe, la commission d’enquête appelle à une évaluation de l’apport pédagogique et éducatif des outils et ressources numériques. Elle encourage à réduire au strict nécessaire leurs usages.
Conscient que l’efficacité d’une meilleure régulation des enjeux numériques passe par l’échelle européenne, la commission d’enquête enjoint le Conseil de l’Union européenne à accorder plus de moyens financiers et humains pour faire respecter le règlement du Digital Services Act (DSA). En France, l’Arcom est l’agence chargée d’assurer le bon fonctionnement du DSA. Aujourd’hui, une partie de l’échiquier politique français souhaite la suppression ou la modification de l’Arcom.
Les réseaux sociaux, avec des algorithmes puissants et secrets, captent facilement l’attention des mineurs. La commission d’enquête propose d’instaurer dans le droit européen une obligation de pluralisme algorithmique qui suivrait celui du pluralisme des médias.
En guise de conclusion
Cette commission d’enquête aura mis en lumière les dangers des réseaux sociaux et spécialement de TikTok. L’environnement des réseaux sociaux et plus globalement du numérique reste encore aujourd’hui très dangereux pour les mineurs (harcèlement, violence, pornographie, addiction…). Dès la publication du rapport de la commission d’enquête, son président, le député Arthur Delaporte, a décidé de saisir la Procureure de la République contre TikTok pour manquements à ses obligations.
Il est impératif que l’État s’investisse davantage, tout en appelant à la bonne intelligence de toutes les parties prenantes. La CNAFC reste attentive et mobilisée sur ce sujet d’importance cruciale pour protéger les jeunes et les familles, cellules vitales de la société. Elle a notamment publié 12 questions à se poser sur les réseaux sociaux pour accompagner les parents.
TikTok pointé du doigt pour ses effets nocifs sur les mineurs
ARTICLE CNAFC. SOINS PALLIATIFS : ACCOMPAGNER LA VIE.
Que sont vraiment les soins palliatifs ? Ne sont-ils réellement déployés qu’en toute fin de vie ? Quelle place font-ils aux familles ? La Vie des AFC donne la parole à deux spécialistes sur un sujet souvent mal connu du grand public.
Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne (Aude) et présidente de la société française des soins palliatifs (SFAP) pour la cinquième année.
Thierry Sergent, bénévole et coordinateur d’équipe en soins palliatifs à la maison médicale Notre-Dame-du-Lac et membre d’Être Là Grand Paris, association d’accompagnement des malades et personnes en fin de vie.
Qu’est-ce qui vous a conduits, l’un et l’autre, à vous engager sur le terrain des soins palliatifs ?
Claire Fourcade Jeune étudiante, je voulais faire de la réanimation néonatale. Et puis, deux rencontres m’ont fait évoluer. Au cours d’un premier stage dans un service d’oncologie, j’ai été frappée et choquée de la façon dont les gens mouraient et du désintérêt profond des médecins pour eux. Juste après, au début des années 1990, j’ai fait un stage dans un service de maladies infectieuses, avec des patients atteints de SIDA, et j’ai vu des soignants très mobilisés dans l’accompagnement de ces patients jeunes. Il y avait un vrai travail d’équipe entre les patients et les soignants. J’ai découvert que c’était cette médecine-là qui m’intéressait, et je suis partie deux ans au Canada me former aux soins palliatifs.
Thierry Sergent Dans mon activité professionnelle, j’avais fait de l’accompagnement de salariés et de dirigeants : quand j’ai commencé à lever le pied, je me suis dit que je pouvais mettre ces — j’espère — capacités d’écoute et de présence au service d’autres personnes, à des moments de la vie où l’on parle plus facilement « vrai ». Je me suis lancé dans ce bénévolat, animé de la conviction que l’homme est un animal communiquant. D’ailleurs, je suis stupéfait du nombre de gens qui finissent leur vie désespérément seuls.
C.F. C’est intéressant, parce que chez nous, en milieu rural, c’est extrêmement rare. Je suis au contraire frappée de la présence des proches, des familles, qui, si on les aide, sont prêtes à s’impliquer et à bouleverser leurs agendas pour se rendre présents. Il faut dire que, chez nous, beaucoup de patients vivent encore dans la même maison ou le même village que leur famille. Mais je retrouve souvent cette différence quand je discute avec des collègues parisiens : on n’a pas du tout les mêmes problématiques, ni en termes d’accompagnement ni en termes de demandes d’euthanasie par exemple.
Quels sont, à vos yeux, les principaux malentendus qui entourent le sujet des soins palliatifs ?
T.S. Je remarque une grande méconnaissance de ce sujet dans mon entourage, même parmi les professions médicales. On ne sait pas ce qu’on y fait, ce que ça apporte. La députée Prisca Thévenot, qui est récemment venue à la maison médicale Notre-Dame-du-Lac, avec humilité, faire un peu d’immersion dans la perspective de la loi, faisait le même constat, se demandant comment œuvrer pour une inculturation sur les soins palliatifs.
C.F. Il faut dire qu’à part des campagnes assez ciblées sur les directives anticipées, il n’y a jamais eu de campagne gouvernementale sur la fin de vie. Pour moi, le principal malentendu, c’est l’idée que les soins palliatifs sont une médecine de la fin de vie. Or ils sont plutôt un accompagnement de la vie avec une maladie grave, ce qui est très différent. Il faudrait développer des soins palliatifs précoces qui permettent de prendre en charge des patients très tôt et de construire avec eux des parcours de soins les plus adaptés possibles à ce qu’ils souhaitent. Cela permet, tout au long de la maladie, de pouvoir décider de quel traitement on veut, ce qu’on ne veut pas, jusqu’où on veut aller, et d’être accompagné dans ces choix-là.
Comment la décision d’entrer dans une démarche de soins palliatifs peut-elle être bien vécue ?
C.F. Là où je travaille, nous n’avons que très peu de patients qui ont pris cette décision. Ça leur est proposé à un moment où cela paraît pertinent, mais il n’y a pas de rupture dans le parcours de soins. Nous avons monté depuis huit ans un hôpital de jour qui accueille à la fois des patients en oncologie et des patients en soins palliatifs, quelle que soit leur pathologie. L’objectif est orienté sur la qualité de vie, que ce soit pendant les traitements, les chimiothérapies, ou quand il n’y a plus de traitement. Il n’y a pas de frontière, ce qui évite cette question difficile de l’entrée en soins palliatifs, comme si on disait aux patients : « Vous qui entrez là, abandonnez toute espérance ».
T.S. À Notre-Dame-du-Lac, c’est un peu différent : les gens arrivent par protocole et n’ont absolument plus de soins curatifs. Je remarque qu’ils n’ont pas tous la même compréhension de ce qui leur arrive, en fonction de ce qu’on leur a dit ou pas, de ce qu’ils ont entendu, de ce qu’ils veulent entendre… Notre équipe de bénévoles visite aussi des patients à domicile, qui sont à des stades de maladie très variés. Parfois, on se demande même si on n’arrive pas trop tôt, d’autant qu’en tant que bénévole, on connaît encore moins le pronostic que le médecin.
C.F. Je trouve qu’il n’est jamais trop tôt pour prendre en charge un patient en soins palliatifs. J’entends souvent en consultation : « docteur, c’est la première fois que quelqu’un m’écoute » : c’est quand même dramatique qu’il faille arriver en fin de vie ou en consultation de soins palliatifs pour être entendu par la médecine pour la première fois ! Plus il y a d’occasions pour les patients d’être entendus plus tôt, mieux c’est, à mon avis. Les prises en charge précoces permettent un apprivoisement du questionnement. Elles sont aussi un très bon remède contre l’acharnement thérapeutique.
Quels conseils donneriez-vous aux familles de malades ? De quelle manière associer les enfants à cette période ?
C.F. En soins palliatifs, on travaille pour la personne en fin de vie mais aussi pour ses proches. Dans mon équipe, nous leur consacrons environ la moitié de notre temps. Quand la fin de vie s’est passée dans des conditions qui ne suscitent pas de colère, de remords ou de regrets, c’est plus facile de continuer à vivre après. Nous leur expliquons aussi ce qui se passe sur le plan médical, et comment ils peuvent être présents.
T.S. Souvent, les familles nous remercient de les avoir aidées à apprivoiser la mort, et nous disent que ce n’était plus possible à domicile. Cela m’amène à être prudent face à cette valorisation qui est souvent faite de l’accompagnement à domicile. Une structure d’accueil peut aussi décharger la famille d’une logistique lourde et de certaines angoisses, et lui permettre d’être juste présente.
C.F. Oui, il ne faut faire un absolu ni du domicile ni des promesses qu’on a faites. Quand des patients avaient désiré mourir chez eux, et que leurs familles le leur avaient promis, il est important de leur dire que ce qu’ils ont promis, c’est de faire du mieux possible. Parfois, c’est très difficile, et il ne faut pas se sentir ligoté par des promesses qui sont intenables. C’est parfois le rôle du soignant de le dire aux proches, et de les déculpabiliser.
On parle beaucoup du manque de moyens en soins palliatifs : quelle en est votre expérience de terrain ? Qu’appelez-vous de vos vœux ?
C.F. La loi garantit l’accès aux soins palliatifs pour tout le monde depuis 1999, or la Cour des comptes, dans son dernier rapport (juin 2023), a montré que seulement la moitié des patients qui en ont besoin ont accès aux soins palliatifs.Donc 150 000 personnes meurent chaque année sans y avoir eu accès. Le manque est évident. Il y a un énorme déficit à la fois de connaissance et d’accès. En ce qui me concerne, notre structure a déposé un dossier pour développer la prise en charge de patients à domicile, qui est très chronophage et pour laquelle nous avons besoin de renforts, et nous ne voyons rien venir. À périmètre constant, il faudrait faire toujours plus, et si on fait plus, on fait moins bien.
T.F. Je suis moins compétent que Claire sur le sujet, mais je remarque que Notre-Dame-du-Lac a énormément de mal à recruter et à fidéliser des soignants. Ce n’est pas simple de trouver du personnel qui a envie de faire du soin palliatif.
C.F. Cette crise concerne l’ensemble du monde médical : il est difficile de trouver des soignants dans toutes les disciplines. Mais au-delà de cette question, faire le choix de la confrontation quotidienne à la fin de vie et à la mort, c’est extrêmement riche mais extrêmement dur et ça nécessite de prendre soin des patients, d’avoir des structures pour leur permettre de tenir et de durer. En vivant à l’ombre de la mort, les soignants ne sont pas seulement concernés, ils sont impliqués.
L’idée de soins palliatifs peut faire peur ou être connotée négativement. Pourtant, il s’agit d’accompagner la vie. Quelles joies vous apporte votre expérience en soins palliatifs ?
T.S. Ce qui me rend heureux, c’est que je fais de vraies rencontres. Je suis impressionné du nombre de personnes qui acceptent de me parler dans ce moment particulier de leur vie. Il ne faut pas croire que nos discussions tournent nécessairement autour de la mort, de ce qui va se passer, de la vie après la mort ou de ce que les personnes ont vécu et qu’elles voudraient absolument nous livrer. Parfois, pendant vingt minutes ou une demi-heure on va parler de tout autre chose, et la personne sera heureuse d’avoir eu cet espace de respiration. Ces visites m’apportent de la paix, et j’espère aussi en apporter un peu, avec humilité.
C.F. Il y a toujours dans une journée au moins une fois où je me dis que j’ai été utile, parce que j’ai pu rassurer ou soulager quelque chose. Sur un plan personnel, je trouve que cette période de la fin de vie ou de la vie avec une maladie grave ne laisse pas de place au superficiel. Il s’y passe des choses très importantes. Quand la vie est comptée, elle est précieuse et on va droit à l’essentiel. Pour moi, c’est une invitation permanente à ne pas attendre la fin de vie pour ordonner mes priorités. Comme soignante, c’est vraiment une aide à vivre.
Pour poursuivre votre lecture: Soins palliatifs : accompagner la vie
COMMUNIQUE DE PRESSE CNAFC : NATALITE 2024. Les AFC appellent les gouvernement à établir un diagnostic précis des besoins réels des français.
Alors que l’INSEE s’apprête à publier un nombre de naissances en baisse de 2,8% en 2024 par rapport à 2023, les AFC demandent au gouvernement d’établir un diagnostic approfondi et précis des attentes des familles françaises pour leur permettre d’accueillir les enfants qu’elles souhaitent.
Le désir d’enfant des Français était de 2,27 en 2023 alors que l’indice conjoncturel de fécondité est seulement de 1,68 enfant par femme en 2023 (il était de 1,84 en 2021). L’écart entre ces deux indices montre que les Français ne parviennent pas à accueillir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent. Pour quelles raisons existe-t-il une telle différence ?
La réponse à cette question est essentielle pour proposer les bonnes solutions. Il ne suffit pas de désigner le climat morose (la natalité baisse partout dans le monde), la menace écologique (elle touche tous les pays développés mais certains redressent portant leurs taux de natalité), la crise du logement (elle n’est pas nouvelle) etc… car les raisons sont très probablement multifactorielles. Il est donc nécessaire de les envisager, les étudier sans a priori et de les quantifier pour poser un diagnostic aussi exact que possible de la situation française.
Entre 2001 et 2021, un certain nombre de pays européens ont effectué ce travail de diagnostic précis et ont pu apporter les réponses adaptées. L’indice conjoncturel de fécondité est ainsi remonté en Allemagne (+17%), en Lettonie (+29%), en Roumanie (+42%), en Slovénie (+35%) et en Tchéquie (+59%), entre autres (Eurostat). Les mesures prises ont été adaptées à la situation initiale de chaque pays et aux besoins exprimés par les familles. En revanche, d’autres pays ont fait de gros efforts sans aucun succès faute de répondre aux attentes des jeunes parents : l’Italie, par exemple, a mis en place d’importantes aides financières en 2021, sans effet jusqu’alors sur la natalité.
La baisse de la natalité met en danger le modèle social français qui repose sur la solidarité intergénérationnelle ; elle met à mal nos perspectives économiques, affaiblit notre influence et notre rayonnement dans le monde sans répondre aux attentes des jeunes couples.
Les AFC exhortent le nouveau gouvernement à réaliser un diagnostic précis des raisons menant à cet écart pour proposer des réformes adéquates aux besoins des familles françaises.