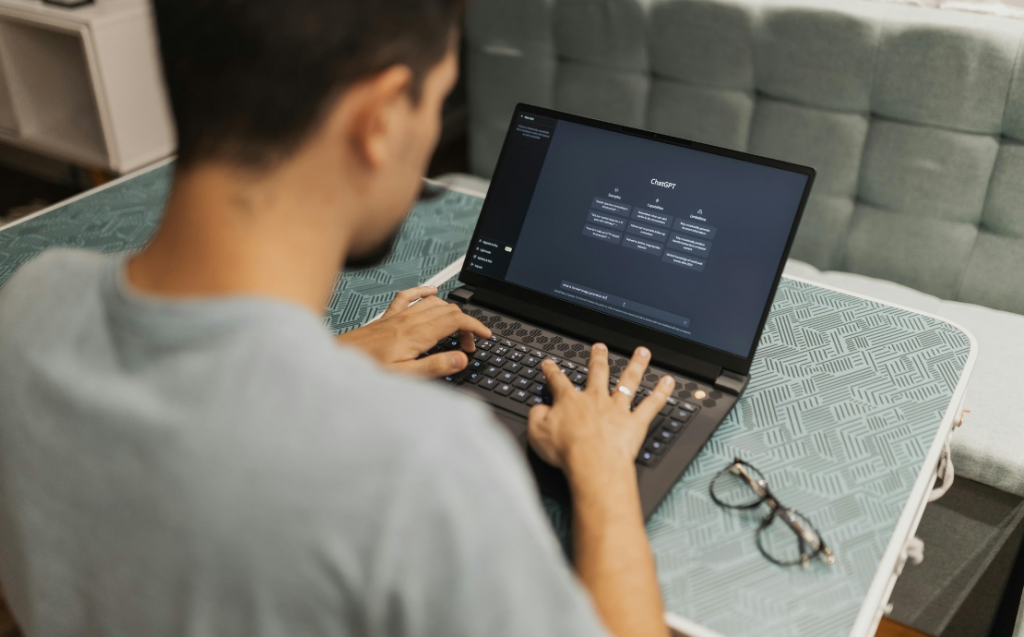Alors que l’IA vient bouleverser les quotidiens, et même la manière d’enseigner des professeurs. Hervé Bry est président de l’AFC de Triel et auteur de La Grande Illusion – le dialogue social au risque des IA génératives (aux éditions de l’Onde). Il nous livre ses conseils pour utiliser l’intelligence artificielle.
Maintenir une vigilance active
Si l’on n’y prend pas garde, utiliser une IA nous conduit à une sorte d’assoupissement et de consentement passif. Il est tentant de croire qu’on a affaire à une intelligence en voyant s’aligner des caractères, des mots et des phrases. Or, les réponses ne sont que des statistiques de vraisemblance. Sur le plan intellectuel : il faut se poser régulièrement la question du degré de confiance que l’on accorde à l’IA, et se demander si l’on maintient un effort constant de réflexion et de construction du savoir. Sur le plan physique aussi, il est mieux d’utiliser l’IA quand on est bien réveillé que quand on est fatigué, pour mieux résister à l’illusion.
Vérifier les sources de l’IA
Il est possible, dans le prompt que l’on écrit, de demander à l’IA de citer ses sources, pour pouvoir les vérifier. Attention, certains biais cognitifs de l’IA peuvent l’inciter à créer de toutes pièces de fausses informations, que l’on appelle des « hallucinations ».
Veiller à la sécurité de ses données
A chaque fois qu’un utilisateur écrit un prompt, il crée de l’information, de la « data », susceptible de devenir accessible pour tout le monde, à moins d’avoir acheté une licence de Large Language Model (LLM), et de le faire travailler dans un milieu domestique non ouvert. Attention alors aux données personnelles que l’on utilise dans un prompt. De même, l’utilisation sans discernement de données confidentielles dans un cadre professionnel peut mettre en péril son employeur.
Attention au vocabulaire
Les concepteurs d’IA ont tout fait pour donner au robot une apparence humaine, en lui donnant un prénom, en la faisant parler à la première personne. Certaines IA peuvent simuler des émotions – « je suis désolé », « je vous félicite ». Quand on les utilise, ne pas les remercier ou les saluer aide à ne pas tomber dans l’illusion.